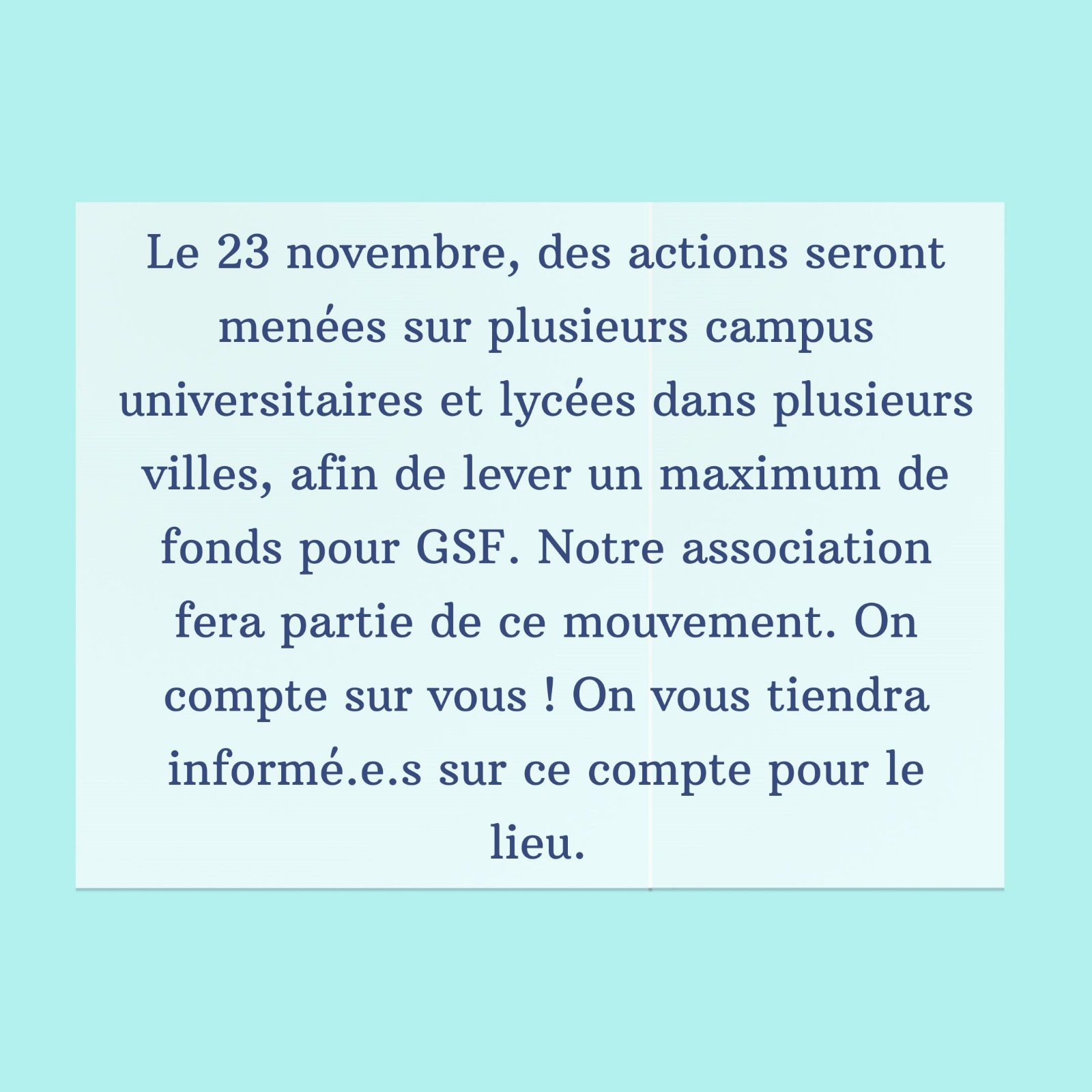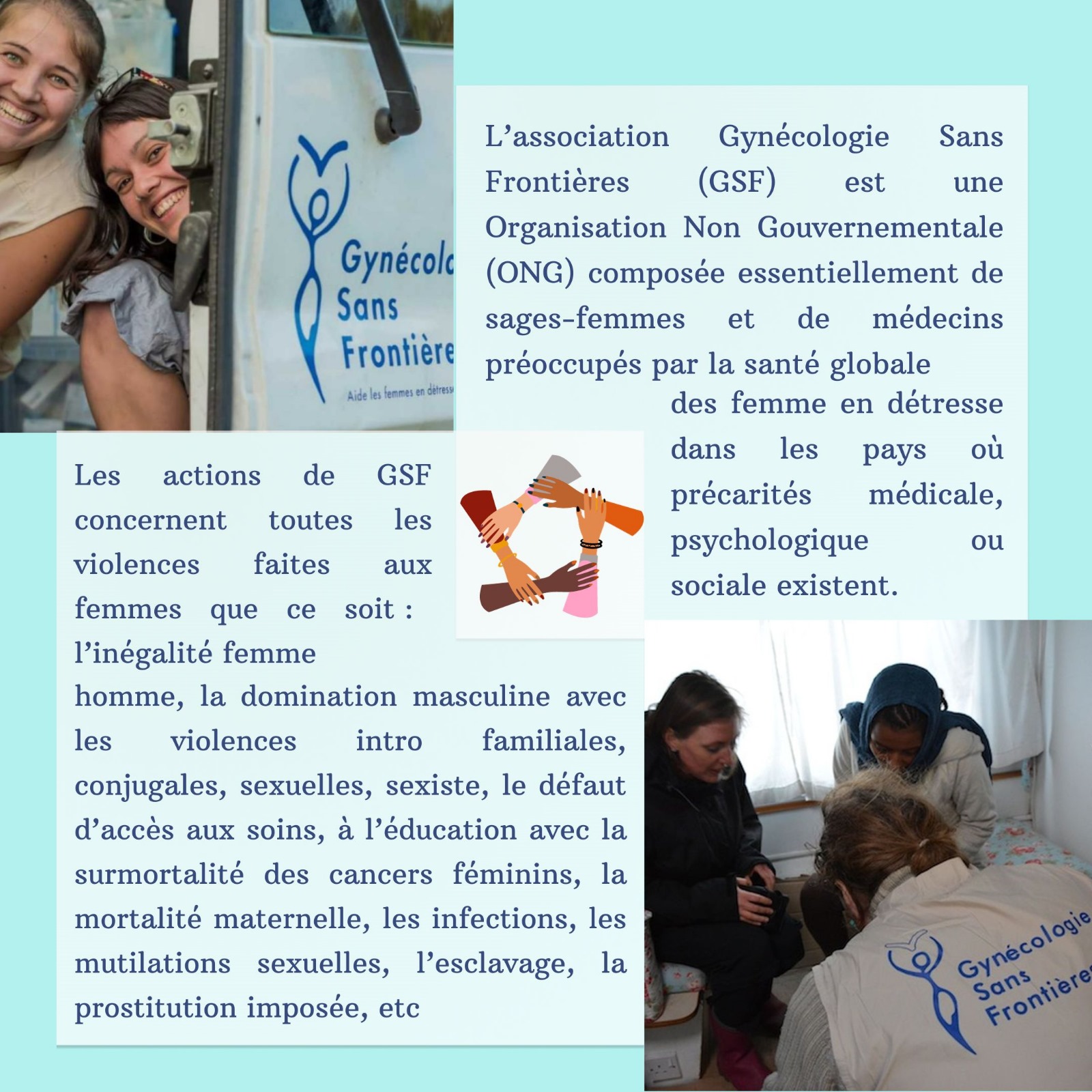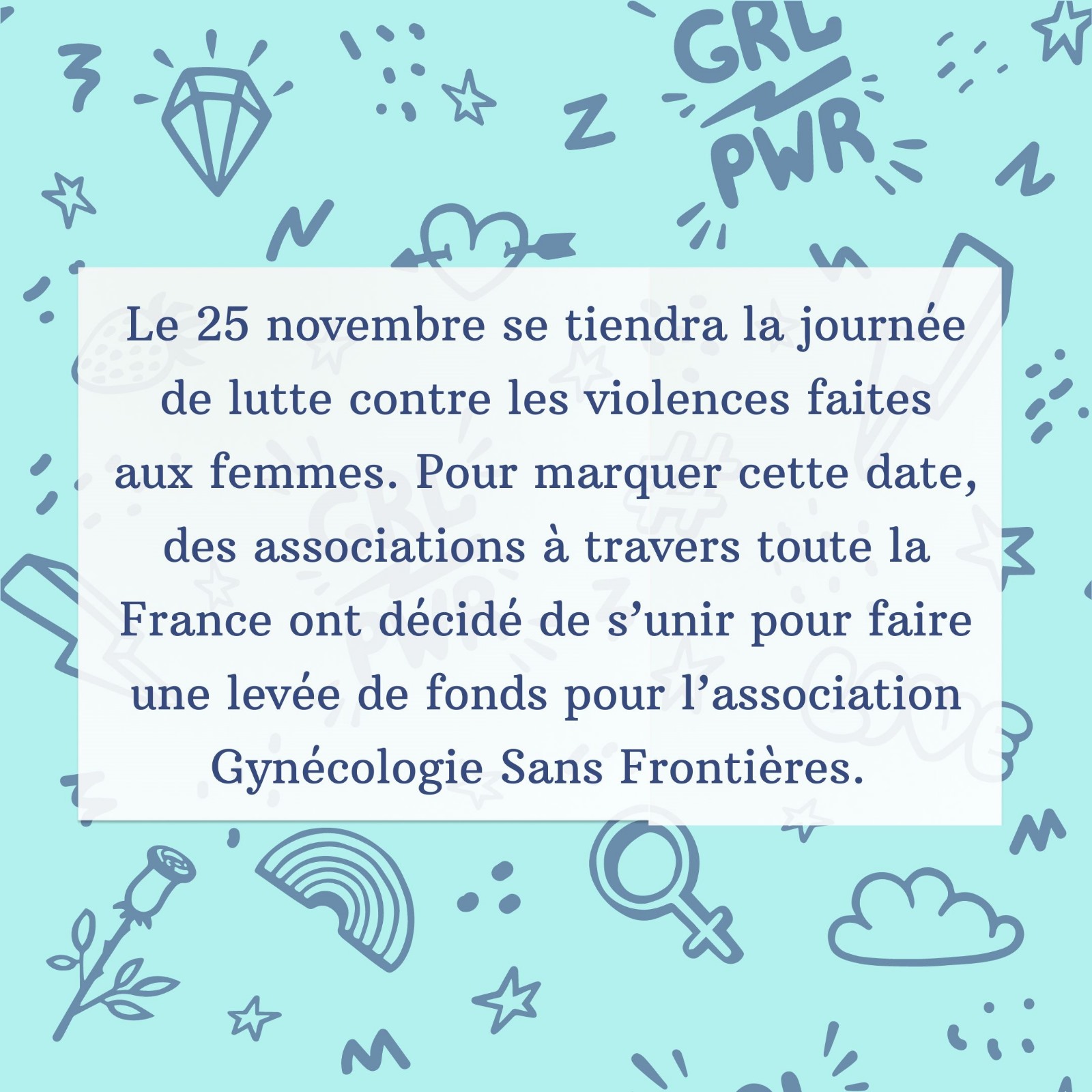La sécurité humanitaire : sur le terrain, comment venir en aide en étant soi-même vulnérable ?
Les humanitaires à risques :
Loin de l’image d’Épinal de l’humanitaire tout sourire, posant avec des bénéficiaires d’un programme mis en place par son ONG, la réalité de l’aide humanitaire implique l’intervention dans des contextes à risques voire à haut risques. De l’acceptation de la mission, aux incidents quotidiens en passant par les événements les plus spectaculaires, la sécurité du personnel humanitaire est un prérequis à toute intervention.
D’années en années, les incidents humanitaires sont de plus en plus nombreux (voir : https://www.aidworkersecurity.org/.) 595 travailleurs.euses humanitaires ont été victimes d'attaques majeures en 2023. Parmi ceux-ci, 280 y ont laissé la vie, 224 ont été blessés, 91 ont été kidnappés.
Dans un contexte international de plus en plus incertain, les plaidoyers pour plus de sécurité du personnel humanitaire se multiplient ainsi que les formations en sécurité, y compris celles disponibles gratuitement, en ligne (https://fr.disasterready.org/).
Les acteurs travaillant pour développer le droit international humanitaire tentent d’entériner plus avant la sécurité du personnel humanitaire dans le droit international comme dans les législations nationales – à l'image des résolutions adoptées lors de la 34ème Conférence internationale du CICR en octobre 2024. La progression du DIH (droit international humanitaire) est nécessaire en raison du fait que les États peuvent être très directement concernés par la protection du personnel humanitaire, prenons l'exemple des 163 humanitaires qui ont perdu la vie sous les bombes israéliennes à Gaza au cours de l'année 2023.
Source : aidworkersecurity
Le fonctionnement de la sécurité sur le terrain :
La recherche ou l'imposition d'un contexte de sécurité absolue n'est pas une fin en soi pour les humanitaires. De manière pragmatique, l'insécurité est un frein au travail sur le terrain ; il faut réduire au minimum cette insécurité pour permettre de travailler efficacement au profit des bénéficiaires. Sur le terrain, la réduction de l'insécurité ne passe pas par une intervention sur le contexte mais par une adaptation des comportements.
Par essence, la position des humanitaires sur le terrain est une position de vulnérabilité. Le personnel humanitaire doit travailler au contact des bénéficiaires et s'exposer aux mêmes menaces directes et indirectes qui les ciblent. Parfois même les travailleurs.euses humanitaires constituent eux-mêmes les cibles privilégiées de groupes armés (agression en cas d'incompréhension des raisons de la présence des humanitaires, enlèvement pour rançon...). Sans moyen de défense, le maître mot en mission est la prévention.
La sécurité humanitaire est avant tout un état d’esprit ; ce n’est pas seulement un ensemble de règles astreignantes. Il n’y a pas de recette miracle, il faut adapter sa conduite au contexte. Sachant que les situations changent et évoluent très vite, la vigilance est de rigueur tout le temps. L’ennemi de la sécurité est la routine.
Les choix d'une "guest house", d'un hôtel, d'un moyen de déplacement, de la zone d'opération, de résidence et de déplacements autorisés sont autant d'exemples d'outils que les ONG peuvent utiliser pour réduire la vulnérabilité du personnel sur le terrain. Les contacts avec tous les acteurs décisionnaires d'une zone d'intervention (gouvernements, groupes armés rebelles, chefs locaux...) sont essentiels pour s'assurer de l'identification et de l'acceptation du personnel sur place.
La sécurité comprend également l'élaboration de procédures d'urgence, d'un plan de contingence pour s'adapter au contexte changeant des missions et la gestion quotidienne des incidents sur le terrain par le truchement d'une liaison efficace avec un.e référent.e.
De la sécurité à la défense face aux évolutions du monde ?
Face à l'augmentation des tensions internationales, à l'explosion des besoins humanitaires, à la baisse des financements des programmes des ONG (suppression d'une grande partie des actions de l'USAID – un des principaux bailleurs de fonds mondiaux), l'enjeu de redéfinir les prérogatives des ONG peut-être source de réflexion.
Dans bien des contextes, les ONG se substituent déjà aux fonctions des États. Nous pouvons penser à la santé, les ONG médicales soignent là où les États ne peuvent/veulent pas rendre les soins accessibles. Il n'est pas illégitime de se demander si un acteur neutre et accepté de tous (Nations Unies, CICR, ONG dédiée, SMP...) pourrait assurer la défense du personnel humanitaire et des bénéficiaires sur des petits bouts de territoire, comme des hôpitaux, en zone de conflits ou d'insécurité.
Une telle méthode à déjà fait ses preuves dans l'est de la RDC où les soldats et apparentés de la RDC étaient souvent aussi menaçants que les groupes armés. Sous le bouclier de la mission des Nations Unies, les survivantes de l'hôpital Panzi ont pu être soignées, le personnel travailler en toute quiétude et même accompagner les femmes victimes des pires violences du Kivu dans des procédures de reconstruction personnelle, professionnelles, de recours juridiques... La défense de l'hôpital a permis de faire davantage pour le personnel et surtout pour les bénéficiaires en agissant directement sur la sécurité du site. Le départ de la MONUSCO (mission de protection des Nations Unies) de la clinique a d'ailleurs été très critiquée.
Source photo : Abel Kavanagh MONUSCO
Pour aller plus loin :
- Dreuil, D. (2016) . Secourir sans périr. La sécurité humanitaire à l’ère de la gestion des risques / Michaël Neuman et Fabrice Weissman (dir.), Paris, CNRS Éditions, 2016, 272 p. Revue internationale et stratégique, N° 104(4), V-V. https://doi.org/10.3917/ris.104.0169e.
- GPR8 - Operational security management in violent environments https://odihpn.org/wp-content/uploads/2010/11/GPR_8_revised2.pdf
- GISF - Toutes ressources utiles - https://gisf.ngo/
Écrit par Louis-Pierre Lacausse