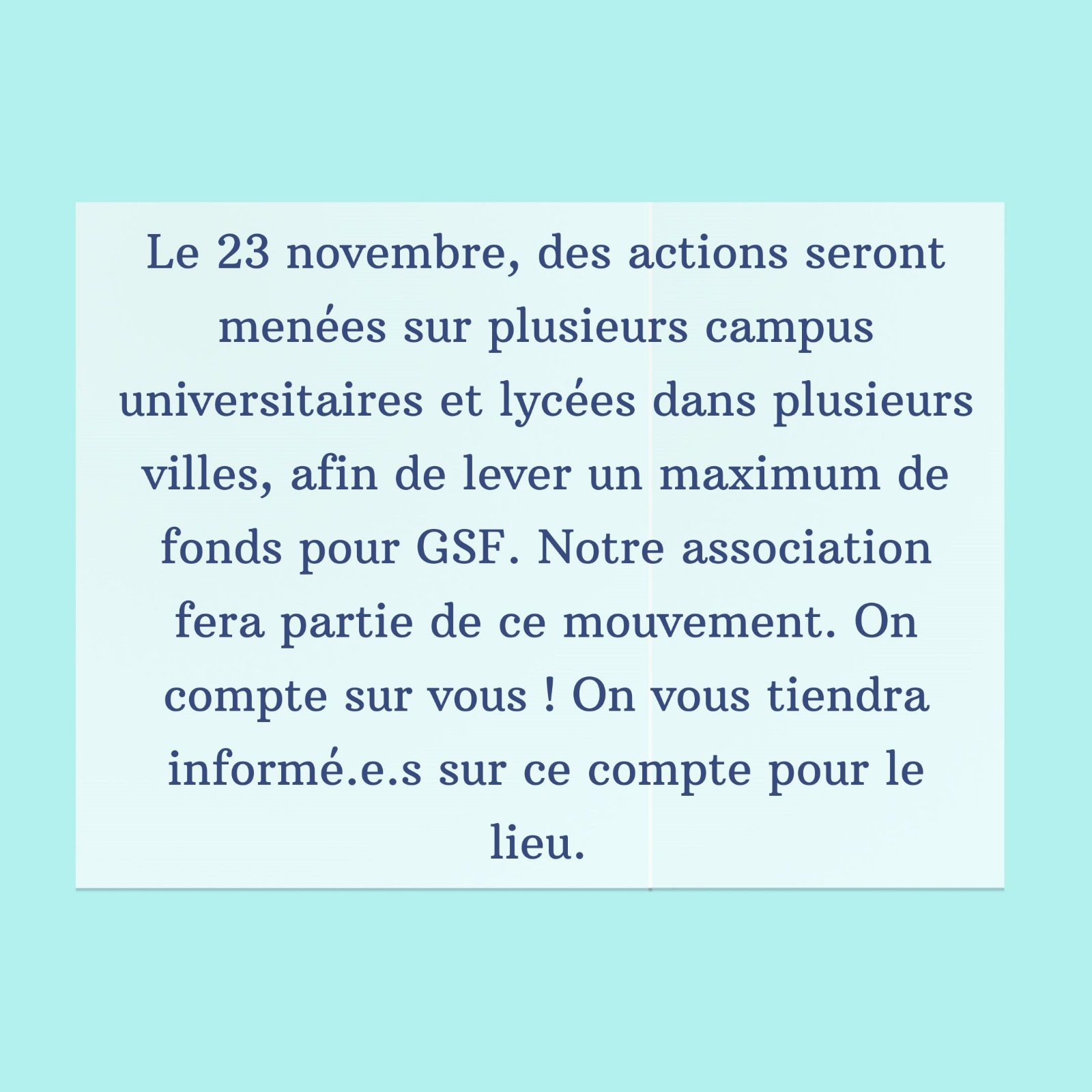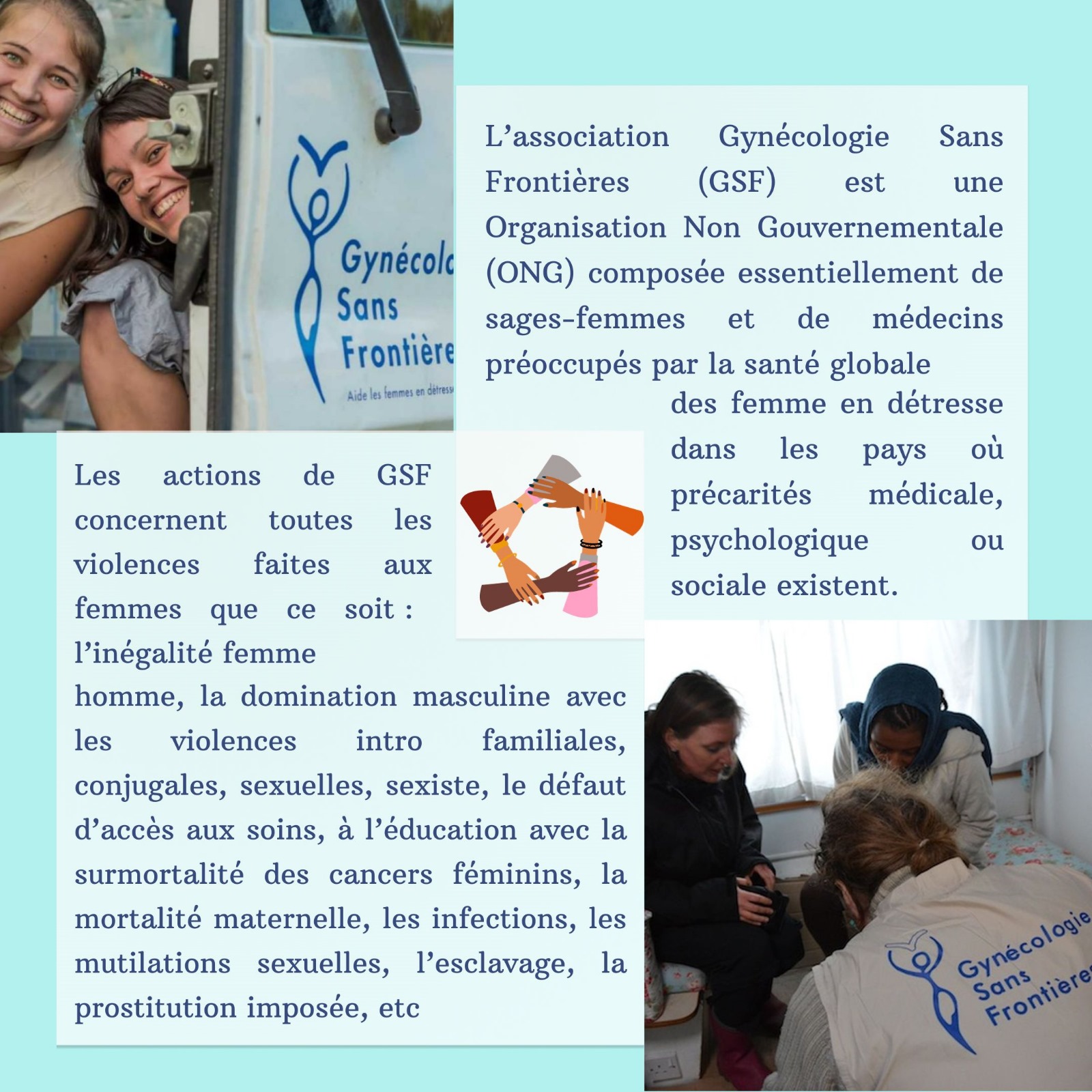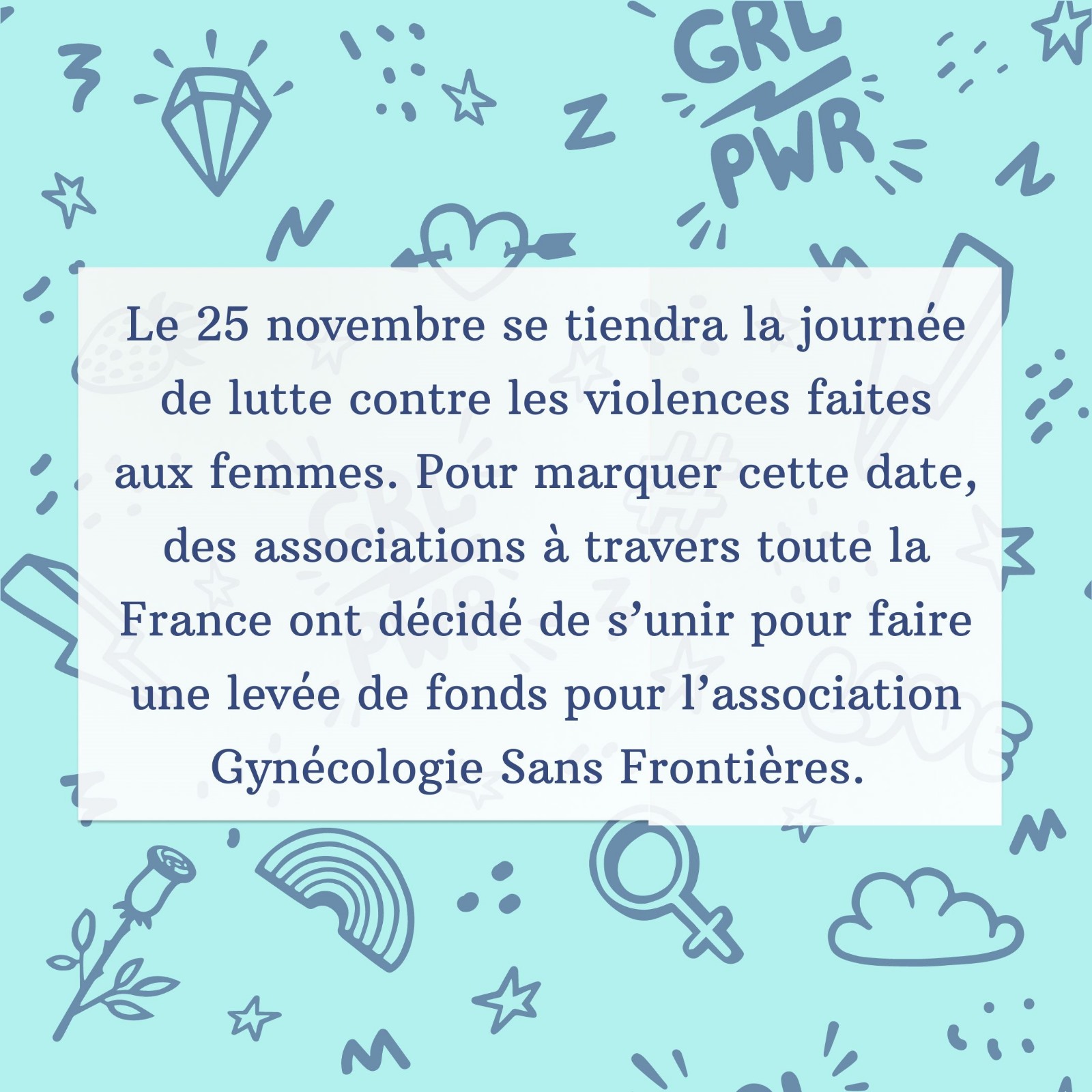Denis Mukwege, le médecin qui répare les femmes
Lorsque j’ai entendu pour la première fois le nom de Denis Mukwege, c’était par mon ami et confrère Bernard Crézé, gynécologue-obstétricien à Angers, membre de Gynécologie Sans Frontières. C’était en 2013. Bernard, aujourd’hui disparu, me parlait avec admiration du combat d’un médecin congolais qui, à l’Hôpital Panzi de Bukavu, consacrait sa vie à soigner des femmes brisées par la guerre. Bernard avait connu Denis bien des années auparavant, lors de sa spécialisation en gynécologie à Angers.
Denis est le fils d’un pasteur pentecôtiste. Après des études de médecine à Bujumbura, capitale du Burundi voisin, il choisit la pédiatrie. Mais ses premiers pas à l’hôpital de Lémera, au Sud-Kivu, le confrontent brutalement à une réalité dramatique : la mortalité maternelle et infantile. Touché par la souffrance des femmes, il décide alors de devenir gynécologue- obstétricien et obtient une bourse qui le ramène à Angers pour sa spécialité.
De retour à Lémera, il est témoin d’un massacre. Malades et soignants sont tués, des femmes violées par des rebelles congolais et rwandais. Denis comprend que l’Est du Congo est devenu le champ de bataille d’une guerre dont l’enjeu est le coltan, ce minerai indispensable à nos téléphones, tablettes et ordinateurs. Pour s’emparer des terres, les milices utilisent le viol comme arme de guerre. Une arme « qui ne coûte rien, mais détruit tout ».
« Mon pays est une bijouterie sans portes ni fenêtres, dans laquelle tout le monde vient se servir », dit-il avec une douleur lucide.
En 1999, il fonde l’Hôpital Panzi à Bukavu. Ce lieu deviendra le refuge de dizaines de milliers de femmes mutilées, que Denis et son équipe vont soigner, réparer, mais aussi accompagner grâce à une prise en charge qu’il veut holistique : médicale, chirurgicale, psychologique, sociale et juridique.
Le combat est dangereux. En 2012, à son retour d’un discours à l’ONU, Denis échappe de peu à un attentat qui coûte la vie à son ami Joseph, son fidèle gardien. Contraint à l’exil en Europe, il sera rappelé au Congo par les femmes elles-mêmes, qui se cotisent en vendant des ananas pour financer son retour. Ce geste scellera son destin : malgré les menaces, il choisit de rester aux côtés de celles qu’il appelle « les survivantes ».
C’est dans ce contexte qu’à partir de 2015, Gynécologie Sans Frontières est sollicitée pour former les soignants de Panzi. Chaque matin commençait par une messe à l’hôpital, suivie d’un mot d’espoir de Denis. Les après-midis étaient consacrés aux cours théoriques, et les matinées aux formations chirurgicales : démonstration, aide opératoire, puis suivi à distance. Par la fenêtre du bloc, je voyais dans la cour ces femmes, entre deux soins, qui tentaient pas à pas de retrouver la vie.
Je me souviens particulièrement de Mukanire Ntakwinja, l’assistant de Denis, à qui j’ai transmis la technique de réparation des prolapsus chez la femme jeune. Il vient d’ailleurs de soutenir sa thèse d’agrégation, avec brio, à Lubumbashi en septembre 2025.
Non loin de Panzi, j’ai découvert la Cité de la Joie, dirigée par Christine Schuler Deschryver. Là, les jeunes filles victimes de viol réapprennent à vivre à travers le chant, la danse, mais aussi le karaté, avec la méthode « Fight for Dignity » mise au point par Laurence Fisher, triple championne du monde.
Mais la guerre ne cesse pas. Elle se poursuit dans un silence international assourdissant. En 2017, pendant l’un de nos séjours, un confrère, Gildo, est assassiné le Vendredi saint. Son corps est déposé à l’hôpital. La Monusco m’interdira d’assister au cortège funèbre.
En 2018, Denis Mukwege reçoit enfin la reconnaissance du monde : le Prix Nobel de la Paix, aux côtés de Nadia Murad. Mais son combat continue, inlassablement, contre l’impunité et l’oubli.
En 2019, avec Gynécologie Sans Frontières et l’Académie nationale de Chirurgie, nous avons lancé à Panzi un diplôme interuniversitaire de pelvi-périnéologie, pour former durablement des spécialistes capables de prendre en charge les séquelles des violences sexuelles.
Aujourd’hui, les violences se poursuivent, Denis est de nouveau en exil, et les rebelles du M23 font régner la peur au Kivu. Mais son combat, lui, ne faiblit pas. On peut lire son livre La force des femmes ou découvrir le film Muganga, celui qui soigne, pour mieux comprendre son message.
Chaque femme violée, dit-il, je l’identifie à ma femme. Chaque fille violée, à ma fille.
Chaque mère violée, à ma mère.
Voilà la voix de Denis Mukwege. Celle d’un homme qui refuse de céder, et qui continue à réparer le monde en réparant les femmes.
Écrit par le Dr Claude Rosenthal
Président d’honneur de Gynécologie Sans Frontières